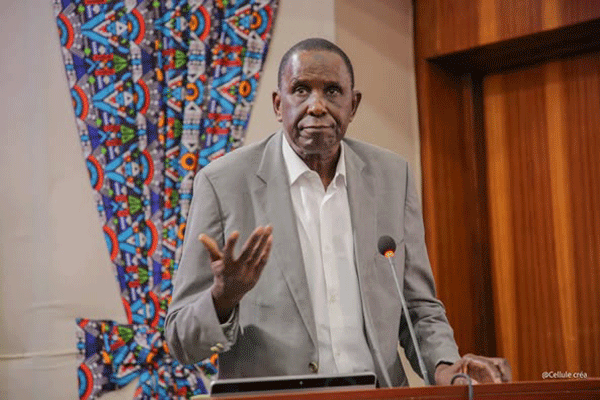Les divergences au sein du couple Diomaye-Sonko ne seraient pas une répétition de l’histoire politique de notre pays, contrairement aux discours qui rappellent les évènements de décembre 1962, opposant Mamadou Dia et Léopold Sédar Senghor. Concernant la probable crise pouvant opposer Diomaye et Sonko, les causes et enjeux sont autres. La rupture entre Dia et Senghor était le résultat d’une crise de conception et d’orientation, de vision stratégique, liée à des options de développement divergentes, sous-tendues par des enjeux géostratégiques du contexte de polarisation idéologique. Dia était partisan de la refondation du modèle économique et de la gouvernance extravertie, hérités de l’ordre colonial. Il préconisait un tournant paradigmatique, par l’instauration d’une économie de développement, en nette rupture avec le paradigme développementaliste de la domination coloniale. Senghor opte, par contre, pour un modèle du socialisme africain, suspendu à la stratégie d’équilibre, s’inscrivant dans sa vision conciliatrice de l’ouverture et de l’enracinement.
Ce qui se dessine sous nos yeux relève d’une perspective par la fabrique d’un modèle de gouvernance illusoire, conçu pour une dualité dans la conduite des affaires de l’Etat. La sortie du Premier ministre, marquée par les relents d’une guerre de leadership et de positionnement pour l’horizon 2029, renseigne sur le désenchantement d’un tel scénario, porteur d’une crise probable au sommet de l’institution étatique. La pathologie du contexte politique actuel, à travers ses variantes dimensionnelles, est révélatrice de lendemains incertains et d’une probable crise de régime pour notre pays. Il est évident que l’hypothèse probable d’une crise politico-institutionnelle est congénitalement liée aux conditions de la troisième alternance où la légitimité politique de Sonko a fondamentalement déterminé la légitimité institutionnelle de Diomaye. Autrement dit, sans Ousmane, Bassirou ne serait pas Diomaye Président. Par ce scénario d’une ascension politique qui n’est pas le propre d’un leadership politique construit par un engagement personnel, le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est mis dans une position de fragilité. La posture du Président est davantage obstruée par l’accompagnement d’un homme dont le style politique se conjugue dans la radicalité, dans la promptitude à jeter de l’anathème sur les autres. La situation née de la crise politique préélectorale par les erreurs fatales de Macky, a mis le Sénégal dans une forme de gouvernance où les prérogatives du pouvoir présidentiel sont constamment mises à l’épreuve par un leadership primatorial surdimensionné.
Du présidentialisme de surplomb, le Sénégal est passé à un présidentialisme affaibli, fragilisé jusqu’au niveau de ses fondements institutionnels. Le conflit entre les deux hommes risque d’être épique, pouvant faire même vaciller la deuxième institution, l’Assemblée nationale, où le parti Pastef dirigé par Ousmane Sonko détient la majorité absolue. Une instrumentalisation de la rue, par des manifestations violentes, peut s’inviter à la crise. Sonko est, par nature, un homme politique qui veut tout conflictualiser, refusant les compromis et adepte de la radicalité et de l’adversité agressive. Dans sa démarche qui tend à rompre avec l’exigence démocratique, l’Etat de Droit, la stratégie de l’homme ne cesse de dériver. La sortie de son avocat, Clédor Ciré Ly, renseigne sur l’état d’esprit d’un groupe dans Pastef qui pense que leur arrivée au pouvoir n’est pas du ressort des mécanismes démocratiques, mais le jeu d’un rapport de force dans le combat politique. Ce qui explique leur prétention à faire prévaloir le droit de museler toutes les voies discordantes. La crise qui pointe à l’horizon, est grosse de risque dans un contexte social et économique difficile. Elle risque d’être une rupture émotionnelle, une rupture de liens, susceptible de conduire à une navigation à l’aveugle de notre pays où les élites dirigeantes perdent leurs liens et repères. Les conséquences peuvent générer un processus de dégradation des représentations citoyennes, la perte de la cohésion sociale et de la stabilité du pays. L’illusion du changement promis cède aujourd’hui la place à une désillusion qu’illustrent les symptômes d’un malaise généralisé et la velléité de porter atteinte aux libertés chèrement acquises.
Aujourd’hui, un spectre nous menace : les avatars de la dérive autoritariste.
La querelle des responsabilités qui agite le récit politique, est une sorte de déconnexion par rapport au contrat éthique, politique et économique pour lequel le couple Diomaye-Sonko a été élu par 54% des Sénégalais qui sont allés aux urnes. Dans ce contexte géopolitique local, s’affirment à la fois la logique de la surenchère et l’échec prévisible. Telle est l’amère réalité d’un contexte où le Peuple est livré à lui-même, jeté dans des conjonctures d’un débat politique en déphasage avec les urgences du moment. Le mal est profond, puisqu’il traduit les défaillances du «Projet pastéfien» tant vanté. Au demeurant, le «Projet» n’a jamais été un condensé programmatique d’une gouvernance résiliente, suffisamment élaboré, pour des transformations systémiques promises. Au-delà des conséquences internes de cette crise en téléchargement, il y a lieu de s’inquiéter dans un contexte sous-régional où les entrepreneurs des crises de rentes sont à la porte de notre pays. La situation exige une attention particulière, dès lors que l’itinéraire des mouvements terroristes, des islamistes fondamentalistes, suit à la trace celui des conflits et crises internes aux Etats. Dans un article publié, je soutenais que les crises qui déchirent le Sahel sont allogènes à un double processus, celui des dynamiques transnationales et celui des processus de multi-localisation de formes de conflictualité alimentées par la lutte pour le pouvoir politique. Les acteurs transnationaux, hors souveraineté, profitent des rivalités entre différents groupes et des faiblesses de la gouvernance politique de nos pays pour y installer le chaos dans la durabilité.
Les connexions entre le mouvement djihadiste, la rébellion Touareg au Mali et les acteurs hors souveraineté comme les narcotrafiquants, avec la manipulation de l’identitarisme ethnique dans ces espaces de conflit, sont révélatrices de cette transnationalisation des conflits à partir des crises internes à nos Etats. Le Sénégal n’est pas à l’abri d’une potentielle éclosion de ce terrible triangle interactif entre l’extrémisme violent (salafisme), la criminalité organisée (narcotrafiquants) et le conflit géopolitique local, autour des enjeux liés, d’une part, aux ressources pétrolières et gazières nouvellement découvertes et, d’autre part, à sa façade maritime propice à l’établissement d’un corridor pour le commerce illicite. Voilà les défis à prendre en compte pour que l’instauration d’une crise au sommet de l’Etat ne soit la boîte de Pandore. Intervenir dans le débat politique n’est pas, pour nous, une prise de position partisane, mais une démarche responsable d’un intellectuel qui s’investit pour la cause de son pays. Je précise, à l’occasion, à l’endroit de ceux qui ont peur de la parole libre, que l’universitaire que je suis n’a jamais flirté avec aucun pouvoir. Je suis formaté par une trajectoire de lutte autour des principes, soumise à l’utopie d’un idéal : soumettre, selon le propos du professeur Alassane Kital, le Sénégal à la noblesse et à la justesse de mes idées.
Professeur Amadou Sarr DIOP
Sociologue
Enseignant-chercheur à l’Université Cheikh Anta Diop