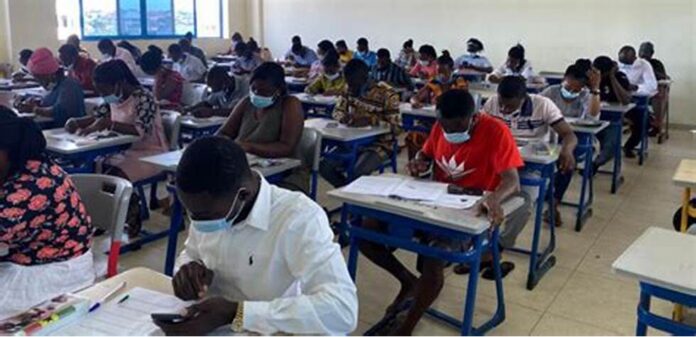L’évaluation joue un rôle central dans le processus des enseignements/apprentissages et peut être à l’origine de plusieurs problèmes qui peuvent affecter la qualité de l’éducation.
La réforme des curricula, avec ses corollaires en termes de centralité de l’apprenant, et l’approche par les compétences doivent être le fil conducteur qui oriente les acteurs du système éducatif pour une pédagogie de la réussite. L’une des reformes les plus urgentes en l’occurrence demeure donc «notre système d’évaluation». La question est de savoir donc comment concevoir des évaluations plus justes et plus objectives.
Si selon De Ketele, «évaluer consiste à recueillir un ensemble d’informations reconnues comme suffisamment pertinentes, valides et fiables, et à examiner le degré d’adéquation entre cet ensemble d’informations et un ensemble de critères jugés suffisamment adéquats aux objectifs fixés au départ ou ajustés en cours de route, en vue de fonder une prise de décision», alors nous devons parvenir à un consensus national à même d’assurer le succès de la refondation du modèle d’évaluation de nos apprenants.
L’évaluation dans notre système éducatif semble se «centrer sur la note plutôt que sur l’apprentissage». Cela favorise «le bachotage» au détriment de l’apprentissage profond. Pour preuve, les élèves se concentrent davantage sur l’obtention de bonnes notes que sur la compréhension des concepts et contenus des enseignements/apprentissages. Se pose aussi la question de savoir si les évaluations sont adaptées aux objectifs pédagogiques : voici quelques préoccupations liées à l’évaluation qui incitent à la réflexion :
-des épreuves parfois difficiles ou mal choisies par rapport au niveau réel des apprenants ;
-des énoncés et formulations parfois ambigus causant une mauvaise compréhension ;
-des incohérences entre ce qui est enseigné et ce qui est évalué.
Par ailleurs, doit-on chercher à comparer les élèves entre eux ou plutôt à les évaluer selon leur progression individuelle ? En tout état de cause, des biais ne doivent pas influer sur notre manière d’évaluer. «Cela crée des injustices, accentue les inégalités scolaires, affectant la performance et le bien-être chez l’apprenant pouvant conduire à une perte de motivation ou même à un décrochage scolaire.» L’évaluation doit être constructive. Elle doit plutôt repérer les acquis, cibler les difficultés en vue d’ajuster les apprentissages. Pour une meilleure évaluation sommative ou certificative, il faut penser à introduire plus d’évaluations formatives, à diversifier les outils, à former davantage les enseignants aux pratiques évaluatives, à mettre l’accent sur le processus d’apprentissage, pas seulement le résultat.
Chez l’élève ou l’étudiant, l’évaluation ne doit pas être seulement «un moment de jugement» qui provoque de l’anxiété. Ce stress peut inhiber leurs performances et les pousser durablement vers un échec. L’évaluation ne doit pas être une source d’échec, mais plutôt un accompagnement pédagogique. Une évaluation «bienveillante» peut renforcer la confiance, surtout si elle reconnaît les progrès, pas seulement les résultats finaux. Quand l’élève est impliqué dans l’évaluation (autoévaluation, coévolution), il devient acteur de son apprentissage et développe son esprit critique. Notre manière d’évaluer interpelle alors tous les acteurs de notre système éducatif et, au-delà, notre Administration dans son ensemble.
Pour «une école de la réussite, une école de la société», il faudra révolutionner notre système éducatif à travers une refondation intégrale basée sur les réalités économiques et socio-culturelles de notre pays.
Khalifa SARR
Professeur-Médiateur pédagogique
sarrkhalifa6666@gmail.com