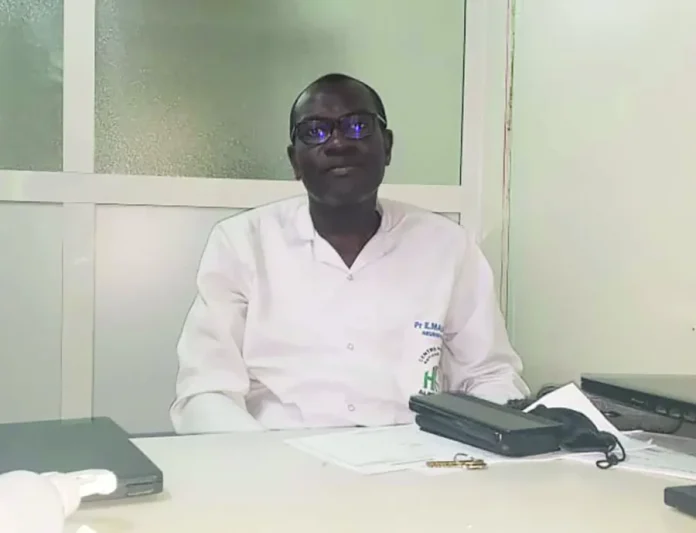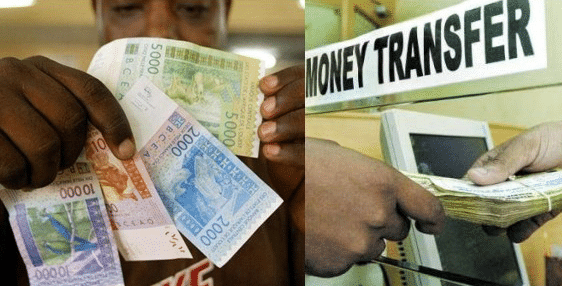De plus en plus, les structures de santé modernes sont construites dans beaucoup de localités au Sénégal, facilitant ainsi l’accès aux soins. Des médecins bien formés et un corps médical dévoué se livrent au quotidien à une véritable bataille pour sauver des vies. Cependant, les accompagnants de malades vivent un véritable calvaire dans les structures de santé. Souvent abandonnés à eux-mêmes, ils souffrent le martyre pour être au côté de leurs parents ou proches hospitalisés.
Ils dorment le plus souvent à la belle étoile, sans lit ni couverture, ou sur les carreaux des salles d’hospitalisation pour ceux qui ont la chance de s’abriter. Fréquemment dépassés par l’état de santé de leurs malades, secoués par le coût exorbitant des ordonnances et autres frais médicaux, ces accompagnants en perdent même le sommeil. Certains finissent même par sombrer dans la dépression.
Hôpital Abass Ndao de Dakar. Le soleil est au zénith. Les blouses blanches se disputent les couloirs avec les malades et leurs accompagnants.Au service de néphrologie, A. Diop discute avec une infirmière. Ce père de famille, parent d’une fille atteinte d’insuffisance rénale chronique, fréquente régulièrement les hôpitaux depuis cinq ans. Très familier avec le personnel médical à cause des nombreuses hospitalisations de sa fille, M. Diop raconte son calvaire depuis le diagnostic.
« À chaque hospitalisation de mon enfant, ma femme et moi nous nous relayons sur une chaise toute la nuit. On nous dit que le lit, c’est pour le malade. Puisque nous n’avons pas les moyens de louer une chambre, nous ne dormons presque pas. Nous payons la salle d’hospitalisation et les frais qui coûtent cher », relate-t-il.
La main chargée d’ordonnances, il court partout pour assurer les soins de sa fille. Assane Diop maîtrise bien les couloirs de l’hôpital pour y avoir passé des mois. Sa fille survit grâce aux sacrifices de ses parents, qui ont vendu tous leurs biens pour assurer sa prise en charge médicale.
« J’ai vendu mon véhicule et tous mes biens. Chaque séance de dialyse pour soulager ma fille me coûte 65.000 FCfa. Elle n’a droit qu’à quatre séances gratuites dans les structures publiques. Je ne dors plus à cause de son état, qui ne s’améliore pas. J’ai peur de la perdre », s’apitoie-t-il.
Face à cette situation, « je n’ai plus honte de tendre la main pour demander de l’aide afin que ma fille puisse être soignée. J’ai d’ailleurs posté des vidéos sur les réseaux sociaux pour demander un soutien, car je veux lui offrir un rein pour une transplantation, qui est plus sûre à l’étranger », se confie Abdou Diop.
Hôpital général de Grand Yoff, autre lieu, même détresse
Il faut être solide physiquement et mentalement pour regarder un proche souffrir. Cette force, les parents la cherchent au plus profond de leur être pour accompagner un être cher malade. Un combat perpétuel qui laisse souvent des séquelles.
Dans les structures de santé, les accompagnants se heurtent à de réels problèmes qui, au fil du temps, impactent leur santé mentale. La cherté des ordonnances et frais médicaux, le parcours de soins sinueux dans les structures, le manque de sommeil, voire le besoin vital de dormir non satisfait, sont autant de facteurs qui rendent difficile le séjour des accompagnants dans les établissements de santé.
Ceux qui sont illettrés et anxieux ne savent souvent pas à quel saint se vouer. Mais ces obstacles ne les empêchent pas de venir au chevet de leurs proches. Ils se faufilent entre les services pour les analyses et autres démarches. Une situation qui crée souvent des tensions entre eux et le corps médical.
Certains d’entre eux dorment à même le sol pour rester aux côtés de leurs malades. Une situation qui, à la longue, impacte leur santé mentale. Certains frôlent la dépression, d’autres sont carrément déprimés.
À l’hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff, la situation est identique. Teint clair, debout sur son 1,75 m, Aïssatou Ba est une jeune femme anxieuse. Le regard perdu, elle livre ses déboires quotidiens pour soutenir son enfant malade. Cette mère de famille, en plus de vivre le chagrin de l’abandon par son mari depuis le diagnostic, doit s’occuper seule de son enfant alité depuis plusieurs jours.
Trouvée dans la salle d’attente des résultats d’analyses, elle s’impatiente en faisant les cent pas. Vêtue d’une robe verte assortie d’un foulard noir, le temps semble s’être arrêté pour cette jeune mère, qui passe maintenant le plus clair de son temps auprès de son fils.
« Cela fait une semaine que mon enfant est interné dans cet hôpital. Je cours partout pour trouver les moyens d’acheter les ordonnances et prendre soin de lui, ce qui n’est pas évident dans ma situation actuelle », lâche-t-elle.
En plus de son inquiétude pour la santé de son fils et de la cherté des soins, Aïssatou doit faire face à un autre défi : trouver un abri. Comme souvent dans les hôpitaux, les accompagnants ne peuvent pas dormir dans les salles d’hospitalisation. Une règle de sécurité compréhensible, mais impopulaire auprès de ces proches qui veillent nuit et jour.
« Le soir, je dors à même le sol dans l’enceinte de l’hôpital pour ne pas être loin de mon fils. J’ai acheté une natte que j’étale la nuit dans ce grand espace (elle pointe du doigt) où beaucoup de parents dorment, qu’il pleuve ou qu’il neige. Car c’est le seul endroit où nous pouvons dormir. Je ne peux pas m’éloigner parce que mon fils peut avoir besoin de quelque chose à tout moment. Nous sommes interdits de passer la nuit dans les chambres d’hospitalisation », se plaint-elle.
Autre structure, même histoire Centre hospitalier national de Pikine accueille du monde en ce début de semaine. Des malades forment de longues files devant les différents services de spécialité. Devant les grilles des deux grandes portes, des vigiles sont postés. Masqués, ils filtrent les entrées.
D’une voix sévère, ils refoulent certains accompagnants, qui doivent patienter jusqu’à 17 h pour voir leurs malades hospitalisés.Sous un grand hangar, devant l’une des grilles, des femmes, pour la plupart couchées sur des nattes, partagent leurs inquiétudes et mésaventures. La fatigue se lit sur leurs visages.
Anta Diène a quatre heures pour se reposer. Accompagnant sa mère hospitalisée, elle profite de la présence de sa sœur pour faire ses courses et se reposer un peu. Comme beaucoup d’autres, Anta flirte avec la dépression. Cette jeune femme multitâche cumule travail, vie de famille et soutien à un parent malade.
Le stress, un compagnon permanent
« Je ne peux plus continuer dans cette situation presque insoutenable. Je dors à peine deux heures par jour, car je dois m’occuper de mes enfants, aller travailler, et assurer la garde la nuit pour surveiller ma mère hospitalisée. Cela commence à avoir des conséquences sur ma santé mentale », reconnaît-elle.
Malgré son état, elle garde la tête froide pour être au chevet de sa maman.
« C’est un véritable calvaire de valser entre mes différentes responsabilités et l’accompagnement d’une personne malade. Je dors sur cette natte chaque matin, à mon retour de travail, avant de relayer ma sœur pour qu’elle puisse, elle aussi, se reposer un peu », précise-t-elle.
Moustapha Dieng vit une situation similaire. Son père, A. Dieng, sexagénaire, est hospitalisé depuis trois jours après une fracture de la hanche.« Mon père souffrait de problèmes cardiaques, donc je passais déjà beaucoup de temps avec lui à l’hôpital. Cette fracture a simplement empiré la situation », regrette-t-il.
En plus de voir son père souffrir, Moustapha doit se plier en quatre pour assurer les soins.« Je dois me montrer fort devant lui, mais je ne vais pas bien. Je suis stressé par l’idée de ne pas pouvoir acheter les ordonnances qui s’accumulent trop vite. J’ai tout le temps la peur au ventre, surtout quand je vois le médecin s’approcher. J’ai peur de décevoir mon père, qui a tout fait pour moi », confie-t-il.
AVEC LE SOLEIL