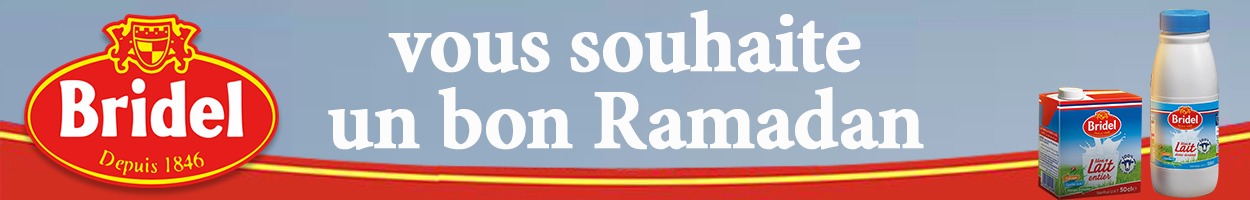Dernière minute : Ousmane Sonko attendu face aux Sénégalais ce dimanche
Quelques heures après le « ndogou » polémique ayant réuni le président Bassirou Diomaye Faye et des députés du PASTEF,…
Donald Trump annonce la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei
Les États-Unis et Israël ont annoncé samedi 28 février avoir lancé des frappes sur l’Iran, appelant les Iraniens à prendre…
Affaire Pape Cheikh Diallo : le journaliste Pape Birame Bigué Ndiaye fait son retour sur la RTS
Après plusieurs jours d’absence consécutifs à des démêlés judiciaires, le journaliste Pape Birame Bigué Ndiaye a repris l’antenne ce week-end…
Me Moussa Bocar Thiam après l’adoption de sa mise en accusation : « Je prends congé immédiatement et regagner le Sénégal pour démonter cette cabale politique »
Me Moussa Bocar Thiam a réagi à la décision de l’Assemblée nationale de le traduire devant la Haute Cour de…
Diomaye face aux députés au « Ndogou Présidentiel » : « La candidature de Sonko en 2029 ne m’engage pas »
Bassirou Diomaye Faye ne s’engage pas sur la candidature d’Ousmane Sonko à la présidentielle de 2029. Du moins, pour l’heure…C’est…
Affaire des homosexuels présumés, situation des supporters détenus au Maroc, crise dans les universités : l’Apr tire sévèrement sur Sonko
Le Secrétariat exécutif national (Sen) de l’Alliance pour la République (Apr) a réagi sur la déclaration du premier ministre, Ousmane…
Affaire de transmission du VIH : un policier arrêté à Keur Massar
L’information judiciaire ouverte dans l’affaire dite d’homosexualité et de transmission du VIH connaît un nouveau développement. Trois nouvelles personnes ont…
Iran – USA : des explosions entendues au moyen orient et à Téhéran
Washington et l’Etat hébreu ont annoncé samedi avoir visé l’Iran, où des explosions ont été entendues dans plusieurs villes, après…
La revue de presse en wolof du samedi 28 Février 2027 avec Mantoulaye Th Ndoye
https://youtu.be/RGHKT9-dlwo
La revue de presse en français du samedi 28 février 2016 avec Fabrice Nguema
https://youtu.be/BJuIh_FFMTc