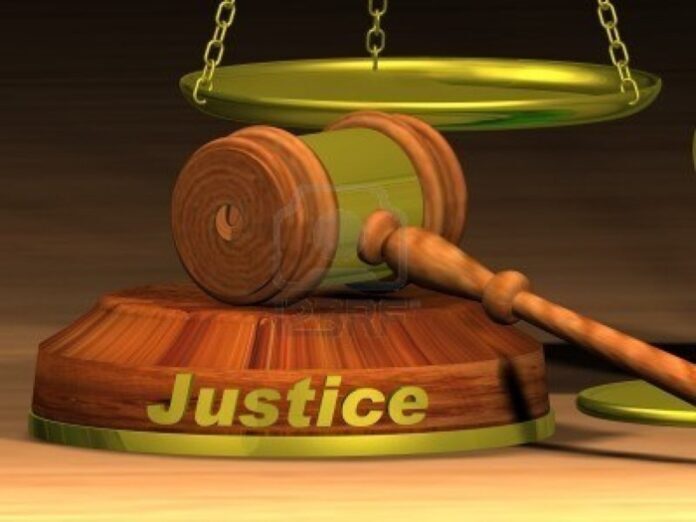La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) est née en 1975 à Lagos, portée par un idéal : bâtir un espace de solidarité où circuleraient librement les hommes, les marchandises et les idées. Cette vision s’inspirait des réussites d’autres blocs régionaux, mais surtout d’une évidence : aucun pays ouest-africain, isolément, ne pouvait relever les défis du développement, de la sécurité et de la stabilité. Pendant un temps, cet idéal a semblé à portée de main. Mais cinquante ans plus tard, l’organisation donne l’image d’un grand malade, fatigué, affaibli et de plus en plus déconnecté des aspirations populaires.
Les récents bouleversements politiques dans la région – coups d’État militaires au Mali (2020, 2021), en Guinée (2021), au Burkina Faso (2022) et au Niger (2023) – ont mis à nu les failles de la CEDEAO. Son réflexe a été d’imposer des sanctions sévères : fermeture des frontières, suspension de la coopération, isolement diplomatique. Ces mesures, censées ramener les militaires à la raison, ont produit l’effet inverse : renforcer les régimes en place, alimenter un discours de résistance nationale et accroître la défiance vis-à-vis d’une organisation perçue comme inféodée à des logiques extérieures, notamment françaises. Dans l’opinion publique, l’image de la CEDEAO a basculé. D’outil d’intégration et de fraternité, elle est devenue synonyme de contraintes, de sanctions et de décisions imposées d’en haut. Les peuples, censés être le socle de sa légitimité, n’y reconnaissent plus leur voix ni leurs intérêts.
Au cœur de la CEDEAO devait se trouver l’intégration économique. Mais ce chantier reste largement inachevé. La libre circulation, proclamée dès 1979, demeure entravée par des frontières jalousement gardées et par une prolifération de postes de contrôle où prospèrent corruption et tracasseries. Les grands projets d’infrastructures régionales – corridors routiers, interconnexions énergétiques, marché commun – progressent trop lentement. Quant à la monnaie unique, l’ECO, elle s’enlise dans des reports successifs depuis vingt ans. Les divergences entre pays anglophones et francophones, l’absence de convergence macroéconomique et les pesanteurs liées à l’arrimage du franc CFA à l’euro empêchent tout progrès réel. Résultat : les échanges intra-régionaux plafonnent autour de 12 % du commerce total, un chiffre dérisoire au regard des potentialités.
À cette crise de légitimité et à ces blocages structurels s’ajoute un mal plus insidieux : la captation de l’organisation par certains États au détriment d’autres. La CEDEAO, censée appartenir à l’ensemble de ses quinze membres, est progressivement devenue l’apanage, voire le jouet, de quelques-uns. La répartition des postes stratégiques, loin de refléter une rotation équitable, illustre une logique de chasse gardée. Le cas du Sénégal est révélateur : malgré son poids politique, diplomatique et économique dans la région, et malgré la règle non écrite de rotation, il n’a jamais eu l’honneur de diriger la Commission de la CEDEAO. À l’inverse, certains pays y placent régulièrement leurs ressortissants aux postes de commande, accentuant l’impression d’un déséquilibre institutionnalisé. Cette surreprésentation alimente le soupçon d’une organisation verrouillée, où le mérite, l’équilibre régional et la symbolique de l’unité passent après les calculs d’influence et les réseaux de connivence. Une telle dérive mine l’esprit communautaire. Elle entretient chez plusieurs États le sentiment d’être marginalisés, relégués au rang de simples figurants dans un projet qui devait pourtant être commun.
La naissance de l’Alliance des États du Sahel (AES) en 2023, regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger est venue consacrer la fracture. Ce regroupement, conçu en réaction aux sanctions de la CEDEAO, revendique une logique souverainiste et sécuritaire. Il attire la sympathie d’une partie des opinions publiques, fatiguées d’attendre les fruits d’une intégration qui n’arrive pas. Cette situation crée une scission inédite : d’un côté, une CEDEAO fragilisée, divisée entre ses États membres ; de l’autre, une alternative qui, bien qu’encore embryonnaire, défie son autorité et menace son avenir même. Si rien n’est fait, la communauté risque de perdre le rôle fédérateur qui lui donnait sens.
Et pourtant, les besoins d’intégration régionale sont plus pressants que jamais. Aucun État ouest-africain ne peut, seul, affronter les défis du terrorisme transfrontalier, du changement climatique, de la crise alimentaire ou de la pression migratoire. La fragmentation actuelle est donc une impasse. La CEDEAO peut encore se relever, à condition d’accepter une véritable refondation. Elle doit rompre avec la logique punitive qui l’a décrédibilisée, corriger ses déséquilibres internes, et replacer les peuples au cœur de son projet. Cela implique plus de transparence, plus d’équité entre États, mais aussi une réorientation vers le développement concret : agriculture, infrastructures, énergie, jeunesse, mobilité. Une CEDEAO utile dans le quotidien des citoyens retrouverait sa légitimité.
La CEDEAO est bien un grand malade. Mais un malade qui peut encore être soigné. Elle devra se réinventer, se démocratiser en interne, adopter une gouvernance plus juste et inclusive, et renouer avec sa vocation première : bâtir une communauté de destin, solidaire et confiante en elle-même. Faute de quoi, c’est l’Afrique de l’Ouest tout entière qui vacillera.
Gabriel Thomas Fall, Citoyen sénégalais et de la CEDEAO